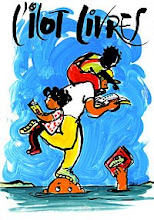HUIT
Le garçon se demanda vraiment si la prof lisait dans ses pensées. Parce que, c’était troublant, cette façon soudaine de parler de Primrose, de son apparence de chien battu qui ne correspondait pas avec l’ambiance de son livre, le Miroir incassable. Le débat du jour portait justement là-dessus : l’écriture est-elle le reflet exact de la personnalité de l’auteur ? Sophia révéla qu’elle connaissait un humoriste qui ne riait jamais dans la vie. Même sur scène il ne riait pas. C’était le public qui se fendait de rire, mais pas lui. La prof répéta la question : l’écriture est-elle le reflet exact de la personnalité de l’auteur ? Personne ne trouva la réponse car, avait ensuite ajouté l’enseignante, il n’y avait pas de règles dans ce domaine. Certains auteurs de romans policier accumulent les scènes violentes, alors que dans la vie, ils tremblent à la vue d’une simple araignée. Qu’est-ce que cela signifie ? Hip eut envie de répondre que les musiques gaies n’étaient pas toujours écrites par des compositeurs joyeux, et vice versa, mais la présence de Sophia dans son dos le tétanisait. Il n’était qu’un radiateur pour elle, il ne fallait pas l’oublier. C’était la pire chose qu’on ne lui ait jamais dite. Passé son moment d’exaltation, de fierté, à la lecture de ce message, Hip avait ensuite déchanté. C’était une triste phrase le concernant. Quelque chose d’effroyablement rabaissant. Car un radiateur ne parlait pas, ne pensait pas. Un radiateur était quelque chose qui ne comptait pas. L’interprétation de la phrase codée n’était pas compliquée. Cela signifiait que Hip n’existait pas à ses yeux. Qu’il était même peut-être simplement invisible.
Alors, forcément, ce n’était pas le moment de parler musique et arcanes de création. Ce fut le cauchemar jusqu’à la fin du cours. Il entendit à nouveau dans son oreille la question : « alors, tu l’as lu ? » Et il mit un point d’honneur à ne pas répondre, comme si Sophia s’adressait à lui dans une langue étrangère.
La jeune fille devait penser qu’il était idiot sous son air de chauve. Mais c’est elle qui l’avait rendu ainsi, qui l’avait ensorcelé, qui l’avait vidé de sa substance. Oui, c’est elle qui jouait avec lui comme avec une marionnette. Jusqu’à s’infiltrer dans ses rêves, ses écrits, sa musique, jusqu’à devenir une héroïne d’opéra. Une héroïne qui le rejetait, au lieu de l’aimer.
C’était facile de jouer avec les sentiments d’un nouveau sans repère. La proie facile. Hip n’avait pas vu le coup venir. Mais maintenant, déçu, humilié, il voulait disparaître de ce champ dangereux. Fuir ce regard qu’il sentait sans cesse braqué sur lui. Sophia l’observait souffrir. Il y avait une sorcière cachée derrière son regard vert. Le garçon se sentait transpercé par son sourire maléfique.
Ce fut une libération de sortir de l’enceinte du collège. Les autres garçons le toisaient d’un air étonné. Hip n’avait pas le moindre contact avec eux. Son bonnet tricoté créait une distance plus encore qu’un fauteuil roulant. Il y en avait dans le collège. Ils étaient parfaitement intégrés. Mais des chauves il n’y en avait qu’un. Il ne fallait pas l’oublier. Hip ne pouvait pas leur reprocher d’avoir peur de l’inconnu. Lui-même s’il croisait un type avec les cheveux bleus, quelle serait sa réaction ? Forcément de la méfiance au début. Il acceptait la mort dans l’âme d’être surnommé Frankenstein. Car tel était son surnom, ici, il le savait. A la place des cheveux, Hip possédait des antennes. Frankenstein était un personnage de roman d’épouvante, la créature d’un savant fou. Et pour Sophia, il n’était qu’un radiateur...
C’était chouette, le collège. Tous les esprits du monde semblaient s’y refléter.
***
Lorsque Hip arriva sur le palier de madame Delange, il entendit des voix derrière la porte. Celle d’un homme en particulier, et le garçon pensa aussitôt au fils de la vieille femme. Et s’il était enfin revenu ?
Il n’eut pas le temps de frapper. Un type jeune, souriant, sortait avec un dossier sous le bras.
- Chère madame, croyez-moi, vous serez mieux là-bas qu’ici, dans cet immeuble insalubre ! Je vous téléphone demain ! Il faut faire vite maintenant !
L’homme passa devant Hip sans le voir et disparut dans les escaliers. La vieille femme semblait attristée. Une fois dans le salon, elle se laissa glisser dans un fauteuil et regarda le garçon comme si elle ne le connaissait pas.
- Qui êtes-vous ?
- C’est moi, Hippolyte, répondit le collégien. Vous vous souvenez ?
- Vous avez retrouvé mon chat ?
- Non, c’est votre portefeuille que je vous ai rapporté l’autre fois.
- Oui… et toi aussi tu veux que je parte d’ici ?
- Non, pas du tout…
- Si… comme lui tout à l’heure. Il m’a soi-disant trouvé un autre appartement, plus moderne que celui-ci, pour le même prix. Dans une résidence protégée. Il a dit qu’il m’aiderait à faire mes cartons, que tout irait bien. Mais moi je sais que lorsque je partirai d’ici, ce sera pour mourir. Je veux revoir mon fils. Tant qu’il ne sera pas revenu, je ne bougerai pas d’ici.
L’odeur était devenue âcre dans l’appartement. Cela provenait du panier à chat, avec cet animal raide comme une buche.
- J’ai votre billet pour la représentation de demain soir, dit Hip. Un taxi viendra vous chercher à 19h30 et vous ramènera après le spectacle.
- Tu as perdu tes cheveux quand tu étais petit ? demanda Marguerite.
Hip piqua un fard, essaya de sourire, puis opina.
- Tu as de la chance, reprit-elle. Tu n’auras jamais de cheveux blancs.
Hip la considéra, interloqué. Il n’avait jamais pensé à ça. C’était super positif.
- A demain ? proposa-t-il gaiement. Nous serons placés ensemble, au premier balcon.
Sur le chemin du retour, Hip composa mentalement un thème en mineur. Une musique pour violon et mouchoir en papier. C’était étrange, car au fond de lui, il exultait en se rappelant les mots de madame Delange. Il n’aurait jamais de cheveux blancs ! Cela faisait longtemps que son crane lisse ne lui avait pas apporté de bonne nouvelle. Ce détail pouvait beaucoup impressionner Sophia. Pour le coup, il devenait un surhomme, un demi-dieu, n’ayant plus avec le radiateur qu’une lointaine ressemblance. La musique mélancolique coulait cependant toujours en lui. Le contrepoint du bonheur sans doute, pour équilibrer les émotions.
Il savait qu’il avait tort de replacer un joker sur Sophia. C’était comme une tentation qui venait le narguer, quelque chose qui écrasait sa volonté.
La nuit tombait et les rues devenaient hostiles. Madame Delange occupait ses pensées. Il lui semblait que Marguerite était une sorte de victime, comme lui, manipulée par des promoteurs immobiliers, aculée à vendre et à partir. Elle ne pourrait rien contre eux. Une seule personne aurait été susceptible de la soutenir et de l’aider à prendre des décisions, son fils. Mais il n’était pas là. Peut-on laisser des vieilles personnes face à des obstacles qu’elles ne pourront jamais franchir ? Laisse-t-on des jeunes enfants sans surveillance ? Telles étaient les questions de Hip sur le chemin du retour.
***
Nicolas avait décidé de s’illustrer à la cuisine, ici, à l’hôtel. Le grand luxe, pour les parents d’Hippolyte, c’était de ne pas manger au restaurant. Delphine achetait tout au marché et revenait avec des poireaux qui dépassaient du sac. Nicolas nouait un tablier autour de sa taille et relevait les manches. C’était si rare que ça en devenait une fête. Ce soir, Nicolas avait invité un ami qu’il avait connu à l’école primaire, aujourd’hui installé à Lille. Un relieur de livres anciens, dont la boutique se situait dans la vieille ville. Champagne, coquilles Saint-Jacques sur lit de poireaux, salade aux noix, fromage, tel était le menu. Nicolas et son ami évoquèrent le bon vieux temps en riant comme des tordus, et au dessert, Pudding composé par Delphine, l’invité remit une enveloppe à Nicolas.
- Qu’est-ce que c’est ? demanda le père d’Hippolyte.
Nicolas décacheta l’enveloppe kraft et découvrit un paquet de photos.
- J’avais ça depuis longtemps à la maison, dit son ami. Tu te souviens de cette époque ?
- Oui ! Nous étions à l’école Albert Camus… là, c’était pendant les vacances, au bord du plan d’eau… et là, en train de jouer au foot ! J’étais tout maigre à l’époque ! Et là…
Hip se pencha par-dessus l’épaule de son père. Il tenait une photo où l’on voyait un homme en costume blanc, qui posait sous un arbre, visiblement en plein été.
- Tu es marrant là-dessus, dit Hip. On dirait un capitaine de bateau !
- Ce n’est pas moi, répondit Nicolas.
- Mais si c’est toi !
- Non, c’est mon père.
- Oui, reprit son ami. Souvent il venait avec nous à la pêche. Il s’allongeait sous un arbre et se plongeait dans un bouquin. Il était plutôt sympa !
- Tu veux dire que c’est papy ? s’étrangla Hip.
- Oui… au même âge que moi aujourd’hui. On se ressemble, non ?
- Plus que ça ! C’est carrément ton sosie !
Hip alla chercher un programme de l’opéra où la photo de son père occupait une pleine page et compara les deux clichés.
- Regarde, on dirait vraiment la même personne. C’est absolument incroyable !
- Oui, confirma Delphine, en observant les photos, c’est à s’y méprendre.
- C’est possible de ressembler autant à son père ? demanda Hip.
- Ca arrive, tu vois, la preuve.
Le garçon opina silencieusement. Une idée tordue venait de s’immiscer en lui. Il mangea le Pudding de sa mère du bout des lèvres. Il n’avait qu’une hâte, filer dans sa chambre, et faire le point. Un truc de dingue était en train de se construire dans sa tête.
NEUF
Hip avait pensé à la ressemblance de la photo de Primrose au dos du livre avec celle du mari de madame Delange posée sur le buffet. Les deux hommes avaient à peu près le même âge sur les deux clichés et, comme avec Nicolas et son père, ils se ressemblaient comme deux gouttes d’eau. L’évidence, folle, improbable, avait brutalement jailli, pareille à une distorsion. Et la question s’était imposée de façon péremptoire : Et si l’écrivain était le fils de Mr et Mme Delange ? Ce fils disparu qui réapparaissait sous le pseudonyme de Primrose ? Hip ne voulait pas y croire. Il remuait la tête. « Non, arrête, se disait-il, c’est n’importe quoi. De la pure fantaisie ». Le garçon essaya de chasser ses idées burlesques. Son imagination s’emballait comme un cheval. Une formule revenait sans cesse dans son esprit : « Primrose est l’enfant de Marguerite ! » Tout s’éclairait : son choix du pseudonyme, pour ne pas porter le nom de celui qui l’avait jeté dehors !
C’était vertigineux et Hip se demanda s’il n’était pas en train de s’inventer un mauvais film. Par où commencer pour savoir ? La réponse s’imposa : demander au principal intéressé, Primrose lui-même.
Le garçon surfa un moment dans les pages jaunes à la recherche du patronyme d’emprunt. Mais l’auteur n’y figurait pas. Il avait essayé sur Lille, sur le département, puis enfin sur tout le pays, en vain. Peut-être l’écrivain était-il sur liste rouge. Le garçon chercha ensuite à « Delange », mais la liste était aussi longue qu’un défilé de quatorze juillet, et il aurait fallu appeler une à une les personnes pour leur demander si elles avaient un lien avec l’auteur du Miroir incassable.
Que faire ? Attendre le retour de l’écrivain dans la classe ? Mais Hip savait qu’il serait incapable d’aller lui parler de cette histoire, comme ça, de but en blanc, en l’apostrophant à la sortie du cours, dans un couloir. L’idée seule lui donnait le vertige.
En arrivant au collège, Hip fit un détour par le bureau du Principal. Il devait forcément connaître l’adresse de l’auteur puisqu’il l’avait invité.
- Tu veux me parler, Hippolyte ?
Le garçon prit une longue inspiration.
- Mon père, qui adore les livres de Primrose, souhaiterait l’inviter à l’opéra, mais il n’a pas ses coordonnées…
- Oh, rien de plus simple ! lui répondit-il, en notant l’adresse sur une carte de visite. Tu diras à tes parents que j’ai été les écouter dans Tosca, c’était… magique !
- Merci monsieur.
Hip ressortit avec le bout de papier dans la poche. Première épreuve réussie.
En fait, ce n’était pas forcément un gros mensonge. Son père aimait peut-être les livres de Primrose. A l’occasion, il lui demanderait. Ses parents connaissaient des tas d’artistes.
Sophia manquait à l’appel aujourd’hui et le garçon vécu cette journée de façon lumineuse. Elle n’était plus dans son dos pour le manipuler de façon télépathique. Il se sentait libéré d’un poids et s’ouvrit aux autres personnes de la classe. Il découvrit des filles et des garçons de son âge, un vrai potentiel d’amis, et cela lui fit du bien. Il oublia même qu’il portait un bonnet tricoté sur la tête. Et même qu’il avait une sorte de lien de parenté avec un radiateur. Il était redevenu lui-même. L’absence de la jeune fille lui donnait enfin le droit de toucher terre. Et même d’avoir des ailes. Parce qu’après la cantine, il s’isola dans la salle de musique avec quelques élèves et improvisa sur le piano. La plupart ne connaissait ni Chopin ni Schubert et Hip interpréta quelques airs du hit parade pour montrer qu’il n’était seulement accroché aux chefs d’œuvre du passé. Quelqu’un lui dit qu’avec son bonnet, il ressemblait à un grand du jazz et Hip se déchaîna plus encore sur le clavier de la salle B115.
Il n’aurait jamais pu s’exhiber ainsi devant Sophia, il le savait. En même temps, il ne pouvait pas s’empêcher d’imaginer qu’elle était là, quelque part dans la salle, fascinée par l’agilité de ses doigts, émue par sa musique, surprise de découvrir une âme sous son bonnet. Oui, il aurait voulu qu’elle assiste à ce moment. Mais lorsqu’il se retourna, il constata qu’il était seul. Les autres étaient partis. Et la cloche se mit à grésiller dans les haut-parleurs de l’établissement.
A la récré, il constata que tout le monde ou presque était au courant de ses talents pianistiques, et il regarda autour de lui pour voir si Sophia n’était pas là, dans la cour, en train d’écouter la symphonie de louanges.
Mais il passa l’heure suivante à s’inquiéter. Pourquoi Sophia n’était-elle pas là ? Il lui était arrivé quelque chose, c’était certain.
Après le dernier cours, il se rendit sur la Grand Place. Derrière la vitre du Furet, il aperçut la mère de la jeune fille devant ses rayonnages de livres. Souriante, elle discutait avec une cliente. Sa fille n’a rien de grave, songea le garçon, sinon sa mère ne serait pas là, en train de papoter. Il avait eu peur de quelque chose d’irréparable. Même s’il ne l’aimait plus, il tenait quand même à elle. A nouveau, il fit un effort pour chasser la jeune fille de son esprit. C’était une sorte de gymnastique perpétuelle. Sophia venait habiter ses pensées à son insu, et lui en retour essayait de la gommer de sa tête. Le problème demeurerait insoluble tant que sa raison et son cœur ne se mettraient pas d’accord sur ce point.
***
Après des recherches sur un plan, Hip fut surpris de constater que l’auteur habitait à Lille même, à quelques pas seulement du centre. Cela facilitait les choses, évidemment, mais cela signifiait surtout que ce n’était pas la distance géographique qui l’avait empêché d’aller voir sa mère. (S’il était bien le fils de Mme Delange !) Si Primrose avait été jeté dehors par son père, suite soi-disant à un vol dans une librairie, pourquoi en voulait-il à Marguerite ? Savait-il seulement que son père était décédé ? Pensait-il un instant que sa mère se morfondait dans le désespoir ?
Tout en se rapprochant de l’endroit où résidait l’écrivain, il sentait une angoisse monter en lui. Il ne savait absolument pas comment il allait lui présenter la situation. C’était délicat comme démarche. Si Primrose avait voulu tirer un trait sur son passé, Hip ne pouvait pas arriver ainsi, la bouche en cœur, lui rappeler un certain nombre de mauvais souvenirs.
La rue proposait un assortiment d’immeubles modernes tous aussi moches les uns que les autres. On aurait dit que l’architecte avait fait exprès tellement c’était réussi. Hip s’arrêta au numéro 19. Une porte en verre, des sonnettes avec interphone. Ses yeux accrochèrent un nom : Delange/Primrose. Le garçon déglutit. C’était bien ici.
A partir de ce moment, une peur panique s’empara de lui et il hésita à sonner. Une petite voix lui disait que c’était son devoir de voler au secours de Mme Delange. Pas d’affect. Exposer seulement la situation à cet homme, pour qu’il sache. Ensuite, il ferait ce qu’il veut, c’était sa liberté. Mais Hip ne pouvait pas ne pas le mettre au courant de la situation dans laquelle se trouvait sa mère. Il lui parlerait aussi de ces promoteurs immobiliers qui tentaient de la chasser hors de ses murs.
Tout ça fonctionnait parfaitement dans sa tête. Mais le trac lui comprimait le ventre et desséchait sa bouche. Pire qu’avant un examen au conservatoire. La musique n’était pas là cette fois pour lui venir en aide. Rien pour se raccrocher ! La sonnette semblait le défier. « Appuie, lui chuchotait-elle, mais appuie donc ! » Mais le garçon demeurait sourd aux injonctions. Il n’avait qu’une envie, débarrasser le plancher au plus vite.
Craignant de tomber nez à nez avec l’auteur, il préféra rebrousser chemin, à la fois soulagé et furieux contre lui-même, et se mit à marcher vite. Il n’avait parcouru que quelques mètres lorsqu’une voix éclata dans son dos.
- Hip ? Mais qu’est-ce que tu fais ici ?
Il se retourna. Sophia l’observait d’un air intrigué. Une alarme se déclencha dans la tête du garçon.
- Je… je me promenais, dit-il, en bafouillant.
- Tu connais quelqu’un au 19 ?
- Moi… euh, non… je… non, personne.
- Pourquoi t’es tout rouge tout le temps ?
Faisant un effort sur lui-même, Hip redressa la tête. Il voulait enfin avoir le courage d’exprimer ce qu’il ressentait. Pour s’aider, il repensa à la façon dont il s’était défoulé aujourd’hui sur le piano du collège, simplement parce que Sophia n’était pas là. Il prit une voix froide et demanda :
- Ca veut dire quoi, « c’est toi mon radiateur » ? Sophia fronça les sourcils.
- Pourquoi tu me demandes ça ?
- Parce que, tu l’as écrit à la fin du livre que tu m’as prêté.
Il fouilla dans son sac.
- Regarde, c’est bien ton écriture, avec le feutre orange : « c’est toi mon radiateur ». Pourquoi tu as marqué ça ?
- Pour rien, fit la jeune fille, en haussant les épaules. C’est à cause de mon chat, il vient toujours sur moi quand je bouquine au lit. Un vrai radiateur ! C’était juste une phrase comme ça. Tu pensais quoi ?
- Je… je pensais rien. Je voulais savoir, c’est tout.
- Savoir quoi ?
- Pourquoi tu avais écris ça.
- C’est si grave que ça ? Au fait, tu peux me rendre le livre maintenant que tu l’as lu ?
- Oui.
- Tu me demandes pas pourquoi je ne suis pas venue en cours aujourd’hui ?
- Non.
Hip lui tendit le roman puis s’en alla sans un mot. Une pyramide venait de s’écrouler sous ses yeux. A présent, un immense désert s’étendait devant lui, arrosé d’une lumière sépulcrale.
Pour commencer, il avait eu des doutes sur la signification exacte du message « c’est toi mon radiateur ». Il avait d’abord cru que Sophia lui déclarait son amour par l’intermédiaire d’une phrase codée faisant référence au texte de Primrose, puis ensuite, après réflexion et analyse, il en était venu à la conclusion qu’il s’agissait au contraire d’une petite phrase humiliante écrite pour le déstabiliser, voire l’anéantir. Mais au final, une autre vérité voyait le jour, bien pire, beaucoup plus douloureuse, quasi désespérante : Sophia n’avait à aucun moment songé à lui, ni en bien ni en mal, en rédigeant cette phrase. Elle avait juste écrit cette formule en pensant son chat. Rien qu’à son chat.
La boucle était bouclée.
***
Hip éprouva le besoin de replonger dans son texte qui lui remplissait le crane. C’était la seule façon de faire revivre Sophia. Il visualisait très bien le happy-end, le moment où le peintre Hippolyte et son amoureuse parviennent ensemble à s’enfuir. « Acte 3, le peintre est amené sur l’échafaud. Ses dernières pensées vont vers Sophia, qu’il ne reverra plus. Pendant ce temps, celle qui a tué Scorpion arrive à la prison pour faire libérer Hippolyte. Mais trop tard, son amant a été exécuté. La jeune femme réalise que Scorpion lui a menti. Pour échapper à la milice qui la recherche (le cadavre de Scorpion venant d’être découvert), elle se jette par la fenêtre. »
Hip soupira. Il n’y avait pas de happy-end possible dans cette histoire. Son destin et celui de Sophia ne se rejoindraient jamais. Comment avait-il pu croire à un tel scénario ? Comment avait-il pu ainsi se laisser manipuler par son imaginaire ? De quel imaginaire s’agissait-il exactement ? Cela avait débuté par une rêverie, une projection, mais très vite, Hip s’était laissé prendre au piège. Jusqu’à en rêver la nuit, jusqu’à croire qu’il menait une véritable double vie, une dans le réel, l’autre durant son sommeil. Jusqu’à soupçonner que Sophia, de son côté, par un effet de miroir, vivait la même aventure sentimentale.
Il avait été, sur ce coup là, le plus idiot du monde. De quoi se cacher de honte. Et en plus, il avait été incapable de se présenter devant Primrose. Avait-il monté cette histoire de toutes pièces ? A présent, il se méfiait. S’il avait des penchants pour l’affabulation, autant prendre des précautions avant d’agir. Hip essaya de faire le point dans le tumulte de ses émotions. Oui, il avait bien trouvé le portefeuille d’une certaine Marguerite Delange. Oui, la vieille femme lui avait parlé de son fils disparu. Oui, la photo de Primrose ressemblait à s’y méprendre à celle de son père au même âge. Oui, les deux noms Primrose/Delange étaient bien accolés sur la sonnette.
Tout ceci était bien réel. Comme sa rupture fatale avec Sophia.
10/
Hip attendit devant l’opéra jusqu’à la dernière minute, moment où les portes allaient se refermer. Il ne restait personne sur le parvis. Les lumières du grand hall avaient baissé d’intensité. Le spectacle n’allait pas tarder à débuter.
Le garçon regagna sa place au premier balcon en dérangeant une allée de personnes assises. Le fauteuil voisin était vide. Marguerite Delange manquait à l’appel. Son père avait pourtant commandé un taxi, Hip était témoin. Pourquoi n’était-elle pas là ? Avait-elle oublié ?
Hip était soulagé sur un point. Marguerite ne ronflerait pas pendant l’opéra ! Mais pendant l’ouverture de Tosca, un scénario catastrophe gangréna l’esprit du garçon. Il visualisa la vieille femme, pressée de descendre les marches fuyantes de son immeuble, perdant l’équilibre, achevant sa trajectoire dans une roulade de cascadeur, pour atterrir sans vie au bas de l’escalier. Les bras de Hip se couvrirent de chair de poule. Il grimaça. L’évocation de cette chute ne cessait de passer en boucle. C’était d’une violence sans nom et il se demanda pourquoi son cerveau était traversé par de telles images. Elles s’imposaient à lui de façon irrationnelle et le troublait au plus haut point.
Marguerite n’était pas là, il lui était forcément arrivé quelque chose. Cela tombait sous le sens.
Hip se sentit envahi par un vif sentiment de culpabilité. Il aurait dû tout de suite la prévenir qu’il avait retrouvé la trace de son fils. Au lieu de cela, il avait attendu, ne sachant comment s’y prendre. C’était sans doute déjà trop tard. Elle était morte peut-être, sans savoir que son fils n’était pas loin, sans avoir pu le revoir.
L’opéra lui sembla affreusement long. Ses émotions restaient bloquées au tréfonds de sa conscience. Il refusait de se laisser troubler par la détresse de Tosca. Il essayait de faire le deuil de Sophia, refusant de l’identifier à cette héroïne vibrant de sentiments, choisissant de mourir pour rejoindre son amour. Un amour qui, pour Hip, n’avait jamais existé autrement que sous une forme utopique. Mais la musique, puissante comme un ouragan, parvenait cependant à lui saisir le cœur, à le chauffer, parce que l’émotion était partout dans l’orchestre et dans les voix, au-delà même de l’histoire et des personnages.
A la fin, Hip rejoignit ses parents dans les loges. Un cocktail était organisé après la représentation. Dans un des somptueux salons du théâtre, une longue table était dressée, décorée de petits fours et de coupes de champagne. Le garçon observa les convives se ruer sur la nourriture et la boisson et dut s’écarter du passage pour ne pas être écrasé. On aurait dit que tous ces personnes importantes n’avaient pas mangé depuis huit jours ! Un véritable raz-de-marée.
Au bout d’un moment, Delphine demanda à une maquilleuse qui partait de raccompagner Hippolyte à l’hôtel. Il allait rejoindre la sortie lorsqu’une silhouette surgissant à ses côtés lui glaça le sang. Ce n’était qu’une paire d’épaules parmi tant d’autres et pourtant il la reconnut immédiatement. C’était comme si un projecteur venait de se focaliser à cet endroit précis. Primrose conversait avec le metteur en scène de l’opéra. Ils semblaient bien se connaître car ils se tenaient par l’épaule. Hip se sentit gagné par une excitation bizarre. Il avait envie d’aller trouver l’auteur et lui parler de sa mère, lui expliquer qu’elle aurait dû être là ce soir, qu’elle avait dû avoir un problème, et que surtout… il devait absolument aller la voir. Hip l’observa dans son beau costume noir, plongeant négligemment les lèvres dans sa coupe de champagne. « Salaud » songea le garçon, qui était furieux de ne pas pouvoir agir comme il l’entendait. Il y avait trop d’adultes ici. En intervenant, il risquait d’attirer l’attention, il n’était pas de taille à lutter. Ses poings se crispèrent dans ses poches. Oui, c’était bien trop compliqué. La maquilleuse le tirait de l’avant et il la suivit, empruntant la somptueuse volée d’escaliers tapissée de dorures.
Il avait l’impression pourtant de bien saisir la complexité de la situation, mais se sentait impuissant. Il touchait à quelque chose d’absolument interdit. Pourquoi se mêler de la vie intime des autres ? Au nom de quoi donnerait-il des conseils à Primrose sur ce qu’il avait à faire ou non ?
Pourquoi ne serait-il pas sensible à la douleur d’un adulte ? Il avait compris la tristesse des personnes âgées. L’abandon les faisait souffrir plus que n’importe quelle autre maladie. Ils étaient comme des petits enfants, perdus dans un monde hostile. Bien sûr, le garçon pouvait imaginer que si Primrose était parti c’est qu’il devait avoir de bonnes raisons. Mais peut-être n’osait-il plus esquisser le premier pas en direction de sa mère ? Même s’il écrivait des choses drôles et farfelues, sans doute souffrait-il en silence lui-aussi. Ou bien au contraire était-il le plus heureux des hommes.
Histoire d’entretenir la conversation pendant le trajet, la maquilleuse lui demanda s’il avait aimé la représentation de Tosca. Le garçon répondit par un hochement de tête. Il était perdu dans ses pensées. Il essayait d’imaginer quelle aurait pu être la rencontre impromptue ce soir de Marguerite et de son fils dans ce magnifique salon de réception. Spécialiste des scénarios sinistres, il imagina la vieille femme, sous le coup de l’émotion, court-circuitée par une crise cardiaque.
En arrivant, il prit une douche pour se laver l’esprit, se brossa les dents, plongea dans son pyjama, et se glissa dans le lit de ses parents. Il avait passé l’âge, mais ce soir, il avait besoin d’un nid.
***
Ce matin, il était heureux d’être invisible pour Sophia. Il n’avait plus cet hypothétique amour dans le dos. Un poids avait cessé de peser en lui, la preuve, il participa activement au cours sans craindre un instant de paraître ridicule. A la récré, il lui proposa une moitié de pain au chocolat, parce que c’était une collègue de classe, ni plus ni moins, une fille parmi tant d’autres, aussi neutre que si elle avait été un garçon. Et ils se parlèrent comme frère et sœur, sans se regarder, sans chercher à attirer l’adhésion de l’autre. Il parlait beaucoup parce que ce n’était pas à elle qu’il s’adressait réellement, mais à une simple présence ou ce qu’il imaginait comme telle. Il devenu le roi du bavardage sans intérêt, de la logorrhée insipide. Loin de lui, éloignée de son cœur. Et elle semblait l’écouter, signe qu’elle pouvait parfois se trouver sur la même longueur d’ondes que lui. Quand elle s’éloigna pour rejoindre ses amies, il conserva cet air superficiel, il savait qu’elle n’était pas loin, et cela lui suffisait.
Et lorsqu’elle le rejoignit dans la salle de musique où il avait pris l’habitude de jouer pendant l’heure de midi, il ne ressentit rien de particulier. Elle ne l’aimait pas, il ne l’aimait pas, tout allait bien. Il n’avait plus de complexes. C’était génial. Et il se mit à transpirer sous son bonnet tricoté à force d’aller et venir sur les touches du piano.
A la fin des cours, il quitta le collège comme une tornade. Personne ne l’attendait, il n’attendait personne. Que de l’air pur. Dans la rue, il conserva ce même pas cadencé et gagna aussitôt la rue de madame Delange. Il n’y avait aucune ambulance garée devant l’immeuble. Pas de corbillard non plus. Mais une chaise sur le trottoir, avec la vieille femme assise dessus, en manches courtes malgré la fraicheur de l’air. Elle semblait attendre quelqu’un ou quelque chose. En réalité, elle dormait sur place, ronflant comme une baudruche crevée. Lorsque le garçon lui toucha le bras, elle s’éveilla en sursautant.
- Qui êtes-vous ? demanda-t-elle.
- C’est moi, Hippolyte. Vous vous souvenez, je vous ai rapporté votre portefeuille l’autre jour ?
- Ah oui…
- Je vous ai attendue hier à l’opéra. Pourquoi vous n’êtes pas venue ?
Marguerite ouvrit grand ses yeux rougis. Elle se leva péniblement et s’appuya sur l’épaule du garçon.
- J’ai fait une énorme bêtise, hier, dit-elle. Si grosse que j’en ai pleuré toute la nuit. C’est pour cela que je ne suis pas venue à l’opéra. Les larmes coulaient, coulaient… Je me suis réveillée ce matin, comme si je sortais d’un songe interminable, toute habillée sur mon lit, et les lampes étaient allumées dans l’appartement. J’ai dormi trois siècles. Et j’ai l’impression d’être tout à fait réveillée maintenant.
- Vous parliez d’une bêtise ?
- J’ai suivi le conseil des promoteurs immobiliers. Je suis devenue raisonnable. Et j’ai signé leur papier. J’ai vendu, je vais partir d’ici pour aller dans une résidence, je vais laisser tout mon fourbi aux Emmaüs. J’ai mis tellement de temps à pouvoir tourner la page. Maintenant, ça y est !
Ils montèrent les escaliers pas à pas, s’arrêtant à chaque palier pour souffler. Mme Delange était en pantoufles et tenait son sac à main serré contre elle. Que faisait-elle dans la rue, figée sur une chaise ? Hip avait cru comprendre qu’elle attendait quelqu’un qui ne venait pas, mais qui ?
Il ne savait pas trop comment interpréter les paroles de la vieille femme. Elle avait l’air soulagée, très détachée soudain, mais elle ne semblait pas dans son état normal non plus. On aurait dit que cette nuit difficile l’avait littéralement transformée.
- A présent, je veux penser à mon avenir, dit-elle en arrivant dans son appartement. A mon avenir qui sera court, je ne veux plus regarder le passé, je veux finir ma vie tranquillement.
Le garçon crut bon enfin de lui parler de ce qui lui brûlait la langue depuis un moment.
- On mettra un mot sur votre porte, pour votre fils, quand il reviendra, avec votre nouvelle adresse ! Moi je suis sûr qu’il va revenir !
La vieille femme le regarda comme s’il venait de proférer une énormité. Elle paraissait toute petite soudain, tassée sur elle-même.
- Cela fait longtemps que je sais qu’il ne reviendra pas.
Le garçon sourcilla. Quelque chose le dépassait. Pourquoi semblait-elle si convaincue de ne plus jamais revoir son fils ?
- Je vais déménager au nord de Lille, continua-t-elle, sur la route de Mouscron. Il y aura toujours une place pour toi, Hippolyte. Tu pourras même dormir quand tes parents voudront sortir.
Hip lui avait expliqué qu’il ne resterait pas plus de deux mois à Lille. Il repartait vers le Canada ensuite, après une escale dans leur appartement à Paris. Mais Marguerite avait oublié. Le garçon n’osa pas rectifier.
La vieille femme lui tendit un cartable en cuir.
- Tiens, je te le donne. C’était à lui, quand il avait ton âge. Maintenant, je vais aller m’allonger, mes jambes ne me portent plus.
Visiblement, Marguerite avait pris l’habitude de dormir le jour. Armé de son parapluie, elle embrassa Hip sur la joue et trottina jusqu’à sa chambre.
- Il y a un moment où il faut savoir partir, dit-elle. On ne peut pas lutter éternellement contre le temps.
Hip fut à deux doigts de lui parler de son fils, (savait-elle seulement qu’il se faisait appeler Primrose ?) il pressentait qu’il y avait urgence, mais il en fut incapable. Il réalisa aussi qu’il n’était pas si sûr de lui. Après tout, possédait-il toutes les preuves que l’auteur du Miroir incassable était bien l’enfant de la vieille femme ? En était-il certain à 100% ?
11/
C’était ce revirement qu’il avait du mal à digérer. Que s’était-il passé ? Après l’avoir attendu pendant tant d’années, Madame Delange semblait maintenant vouloir fuir son fils. Tout paraissait extrêmement compliqué dans cette famille. Il ne comprenait pas. Tout en s’éloignant, il ressentit le poids d’une immense solitude. Il était entré en résonnance avec Marguerite, comme si la douleur de la vieille femme était devenue aussi la sienne. En langage musical, il vibrait par sympathie, amplifiait l’écho d’une plainte lointaine et lancinante. Il tenait le cartable du jeune Delange ; c’était écrit au stylo à bille à l’intérieur, sur le cuir tanné par les années.
Marguerite avait enfin décidé de s’en séparer pour gommer le passé. L’attente avait dépassé son seuil de tolérance. Mais pourquoi n’avait-elle jamais de son côté entreprit des recherches ? Elle ne savait pas si son fils était vivant ou pas. Elle n’avait parlé que du jour où, chassé par son père, il avait quitté la maison. Pourquoi n’avait-elle pas essayé d’en savoir plus. Le garçon ruminait cette question atroce. Il savait que, dans son cas, ses parents auraient remué ciel et terre pour le retrouver. Peut-on penser à la place d’une personne qui souffre ? Face à une situation, chacun réfléchit et agit à sa façon. Et puis, que savait-il au fond de toute cette histoire ? Il connaissait ce que Marguerite lui avait raconté. Et quand on parle, on ne dit pas forcément tout. Elle avait peut-être, durant des années voyagé sans cesse sur les traces de son enfant. Comment savoir ? Comment entendre le vide dans les mots de quelqu’un qui ressasse toujours la même histoire ?
Il existait une alternative. Ne rien faire. Oublier le lien entre le portefeuille d’une vieille dame et la visite d’un écrivain dans une classe. Déconnecter le réseau. Oublier un enchaînement. Défragmenter l’histoire. Et fuir dans le non dit. Hip était tenté. Cela aurait eu le mérite de ne déranger ni Primrose ni sa mère. Après tout, n’était-ce pas la solution ? Cesser toute nouvelle entreprise liée à cette bizarre et incompréhensible histoire de famille. La mère et le fils avaient vécu des années dans la même ville sans se voir. Aujourd’hui, ils n’avaient certainement pas besoin d’un entremetteur pour les rapprocher. Cela, c’était le langage de la raison. « Je sais des choses que je ne devrais pas savoir, je n’y peux rien, je ne suis pas responsable. »
L’espace d’un court instant, Hip ressentit un vrai soulagement. Cette minute sonnait la fin de ses tourments. Il allait redevenir un garçon serein, à la vie structurée, studieuse et musicale. Il allait jeter ce cartable à la poubelle, ne plus retourner chez Marguerite. Il allait également sécher le cours dans lequel Primrose devait intervenir. Voilà, c’était parfait, de cette façon, le dossier serait définitivement clos. Il voulait agir comme avec Sophia. Rompre avec ce qui le faisait souffrir. Ne plus s’investir dans des scénarios anxiogènes.
Mais le garçon oublia de jeter le cartable patiné dans une poubelle. Il le ramena dans sa chambre et le rangea dans un placard. Sa penderie secrète, rien que pour lui, avec les gros oreillers sur la dernière tablette. C’est là qu’il cachait un biberon. Il l’avait acheté dans une pharmacie et la vendeuse lui avait demandé s’il avait un petit frère ou une petite sœur. Il avait simplement sourit et elle n’avait pas insisté. Il mit de l’eau dedans, s’allongea, et suça la tétine en fixant le plafond. Ensuite il jetterait cet outil de régression, juré. Il ne devait plus toucher à ces choses, sa mère le lui avait déjà dit. Ce qui était normal pour un petit enfant ne l’était plus pour un collégien. Mais parfois, c’était plus fort que lui, il avait besoin de se raccrocher à une tétine de latex. L’apaisement venait alors à lui, dans la tiédeur d’un silence intime.
***
La prof avait le chic pour imposer la pression.
- Il reste des retardataires pour le récit à remettre à Monsieur Primrose.
Elle regarda Hip.
- Hippolyte, tu peux me déposer ton texte demain dans mon casier ?
Le garçon hocha la tête et offrit un sourire de façade. Il ne viendrait pas le jour de la visite de Primrose. Pour tomber malade, avec de la fièvre, c’était simple. Il suffisait de passer une heure sur le balcon en pyjama, de trembloter, de laisser venir les frissons, d’éternuer, et ça y était, le mal était fait.
Il était hors de question qu’il participe de près ou de loin à cette expérience d’écriture. Il ne voulait plus entendre parler de Primrose, ni de sa vieille mère. C’était quelque chose que le garçon devait absolument oublier.
Hip n’assista pas à la représentation du soir. Il avait besoin d’être seul dans sa chambre d’hôtel, dans une merveilleuse solitude.
Il était seul mais cela n’était pas suffisant pour l’apaiser totalement. Quelque chose se déplaçait avec lui, se cachait tantôt dans son dos, tantôt au dessus de sa tête, une ombre, un contour mal défini, sans visage. Quelque chose d’opaque et de pesant dans le silence. Qui le surveillait. Et qui semblait ne pas vouloir le lâcher d’une semelle. Un remord ?
Il resta un long moment allongé sur son lit, les yeux grand ouverts. Puis il se leva et ouvrit son ordinateur. Il écrivit. Il écrivit longtemps, sans rompre le tempo, comme s’il jouait un concerto de Chopin. Et le clavier obéissait, pareil à un cheval monté par un cavalier directif. Hip transcrivait simplement l’histoire qu’il était en train de vivre. Les phrases s’enchaînaient. C’était le tourbillon dans sa tête. La volonté frénétique de tout dire ne le quittait pas. Un exploit dont il ne se serait jamais cru capable. Lorsqu’il regarda l’heure, il constata qu’il avait écrit pendant une heure sans s’arrêter. Tout était là, dans le texte. Ce récit, il allait l’envoyer à Primrose, qui le lirait, et qui se reconnaitrait. Il apprendrait l’attente de sa pauvre mère, le décès de son père. Il aurait le choix enfin de se manifester ou non. Il serait libre de revenir sur son passé.
Par certains aspects, cela ressemblait à un rapport de détective privé. Tout y était soigneusement consigné. A la loupe. Tout ce que lui avait raconté madame Delange se trouvait retranscrit, avec des dates, des détails intimes : par exemple ce jour où il était parti, chassé par son père, à la suite d’une histoire de vol dans la caisse d’une librairie. Hip n’avait pas omis non plus de lui décrire l'état mental aujourd’hui de sa mère, qui soudain avait décidé de déménager. Il fallait que Primrose sache que sa mère n’allait bientôt plus habiter dans son ancien appartement. Il fallait qu’il puisse la retrouver s’il en avait envie. C’était aussi simple que cela. Rédiger une sorte d’état des lieux, un rapport concis de la situation. Ce n’était pas de la littérature, encore moins du roman, c’était juste le retour d’une observation. En tous cas quelque chose que n’apprécierait pas la prof de français, bloquée sur son mot « fiction ».
La littérature était compartimentée. Une même idée pouvait être abordée côté roman, poésie, récit, ou témoignage. Elle pouvait être entendue d’une multitude de façons. Il existait un regard unique, propre à chacun, qui éclairait le sujet d’une lumière toute personnelle. La musique était elle aussi cloisonnée. Des symphonies, des poèmes symphoniques, des opéras, des toccatas, sonates, concertos, fantaisies, passacailles, suites, partitas… Autant de cadres et de mesures pour un même sentiment.
Certains préféraient écrire des chansons, ou des romans, d’autres aimaient plutôt relier des livres anciens ou travailler le bois, d’autres encore parvenaient à vivre leur vie comme un éternel cadeau quotidien. La vie primitive devenait compliquée. Pareille à une musique de Bach, proche et loin des hommes. Comme l’amour.
Question amour, Hip avait cotisé. Plus jamais ! C’était son crédo. Des Sophia et des Tosca, c’était terminé. Il repartirait de Lille le cœur léger. Sans rêve inachevé.
Pour être en total accord avec lui-même, il rédigea également l’histoire du peintre Hippolyte, aimé de Sophia, persécuté par Scorpion. Il déposerait le texte le lendemain dans le casier de la prof. Puis il irait poster la lettre dans la boite de Primrose.
Ensuite, la journée lui parut affreusement longue. Il ne pouvait pas rentrer à l’hôtel. Depuis que les représentations avaient commencé, Delphine et Nicolas ne travaillaient que le soir. Les journées étaient consacrées à l’étude de nouveaux rôles. Impossible de mettre les pieds à l’hôtel sans se heurter à des embêtements. Il marcha des heures, faisant le tour de la ville. Il avait froid. Il était sur le point d’entrer dans une galerie marchande, lorsque son regard visa deux personnes installées autour d’une petite table, derrière la baie vitrée d’une brasserie. Le garçon se rapprocha, sur le côté, de façon à ne pas être vu. Ce qu’il avait cru apercevoir se confirma. Il connaissait ces deux hommes, suffisamment en tous cas pour les identifier. Le plus bizarre était de les voir ensemble, c’était même tout à fait incompréhensible. Le plus jeune, Hip l’avait croisé chez madame Delange. Il s’agissait du promoteur immobilier, celui qui en partant avait dit à la vieille femme : « Chère madame, croyez-moi, vous serez mieux là-bas plutôt qu’ici, dans cet immeuble insalubre ! Il faut faire vite maintenant ! » Son interlocuteur, en face, un homme plus âgé, et dont Hip fixait le profil, n’était autre que l’écrivain Primrose.
Hip soupira. Il en avait assez soudain. Le monde se rétrécissait autour de cette histoire. Que faisaient ces deux hommes ensemble ? Leur rencontre avait-elle un lien avec Marguerite Delange ? Si tel était le cas, cela signifiait que Primrose gardait en réalité un œil sur sa mère et qu’il était mouillé dans cette affaire de déménagement. Pourquoi ne se montrait-il pas devant elle ? Pourquoi ne reprenait-il pas contact ?
C’était un élément nouveau qui bouleversait les données. Une nouvelle fois le garçon se sentit devancé par les évènements. Tout tombait à plat. Une sentiment d’impuissance le terrassait. La lettre qu’il avait adressé à l’auteur ne servait à rien. Elle ne lui apprendrait rien qu’il ne savait déjà. Ridicule.
Hip eut juste le temps de se cacher lorsque les deux hommes sortirent du bar. Ils se saluèrent sur le trottoir et prirent des directions opposées. C’était l’heure pour l’auteur de se rendre au collège. Le garçon le regarda s’éloigner avec un mauvais sourire. Comment ce fils avait-il pu passer autant de fois devant l’immeuble de sa mère sans jamais monter la voir ?
Ce n’était pas difficile à comprendre : cet écrivain était un sale type. Il avait laissé souffrir sa mère durant des années. Et maintenant, dans son dos, il réussissait à la faire admettre dans une Résidence pour personnes âgées. Il lui avait fait vendre son appartement par l’intermédiaire d’un agent immobilier véreux. Vraiment un type nul, Primrose. Un prétentieux, avec une tête de chien battu, qui écrit des choses absurdes, même pas drôles, pendant que sa mère patine sur la pente douce. Beurk, cela donnait envie d’arrêter de lire. Il était soulagé de ne pas être au collège aujourd’hui. Rien que pour ne pas voir la tête de ce salaud, il était prêt à errer encore des jours dans la galerie commerciale, bien au chaud.
12/
Hip se rapprocha de l’hôtel vers 17 heures. Ses parents buvaient un thé sur une table encombrée de partitions.
- C’est quoi ce cartable en cuir dans ta chambre ? demanda Nicolas.
- Tu as fouillé dans mon placard secret ?
- Je cherchais une couverture.
- Ah.
- Alors, ce cartable ? Tu as fait les poubelles ?
- Oui, répondit Hip, trouvant l’idée excellente.
- Si tu veux un nouveau cartable, demande-nous de l’argent, dit Delphine, levant les yeux de sa partition. Inutile de jouer au clochard. Mon fils un chiffonnier !
- Si tu aimes les vieilleries, reprit Nicolas, je t’emmènerai au marché aux Puces. Tu sais qu’il y a encore des violonistes qui trouvent des merveilles dans ces brocantes. Moi-même j’avais déniché une belle mandoline pour les Noces de Figaro.
Nicolas se mit à chanter un air de l’opéra de Mozart en gesticulant de façon comique. Delphine s’allongea sur la liseuse avec un roman et Hip déballa ses affaires sur la table pour faire ses devoirs.
- J’ai eu un 5 en musique, dit le garçon.
- Sur dix ? demanda Delphine.
- Non, sur vingt. J’avais oublié ma flute à bec.
- Dis-moi, attaqua Nicolas, il est franchement con ton prof !
Delphine intervint vivement.
- Cesse de t’emballer toujours comme un cheval. Tu dois valoriser l’école. C’est notre rôle de parents. Ne critiquons pas les professeurs d’Hippolyte.
- Très bien, dit Nicolas en se tournant vers son fils. Alors, qu’est-ce que vous faîtes en ce moment à l’école ?
Le garçon haussa les épaules.
- Des trucs…
- Fantastique. Et qu’est-ce que tu lis?
- Rien.
- Ben si, je t’ai vu plusieurs fois t’endormir avec un bouquin. C’était quoi ?
- Le miroir incassable.
- Le miroir incassable ? De Primrose ?
- Oui, répondit Hip, la gorge sèche.
- On l’a vu l’autre soir à l’opéra ! On le connaît depuis longtemps.
- Ah…
Le garçon se servit un verre d’eau et le but devant l’évier. Il était nerveux subitement. La voix de son père reprit.
- Nous l’avons rencontré à l’opéra de Marseille, il y a une dizaine d’années. Il avait écrit le livret de l’opéra de ce jeune compositeur russe…
- Kromesky, dit Delphine.
- Oui, c’est ça… Puis nous étions allés voir une adaptation théâtrale d’une de ses nouvelles, le Radiateur.
Hip revint dans le salon, les jambes en fromage blanc. Il avait l’impression d’être entré en plein cauchemar.
- Hip, tu l’as lue ?
- Quoi ?
- La nouvelle du radiateur ! Géniale, non ? C’est bien qu’on vous fasse lire des livres d’aujourd’hui au collège. Ca change des Victor Hugo et compagnie. Primrose, c’est l’écrivain des Flandres, brouillard et humour belge, concision. Un type sympa par ailleurs.
- Il est carrément adorable, ajouta Delphine. Pas du tout le genre écrivain prétentieux.
- En général, le talent va avec l’humilité. Tiens, j’aimerais bien le relire, tu as le bouquin, Hippolyte ?
- Euh, non, c’est une fille de la classe qui me l’avait prêté parce qu’il n’y en avait plus au Furet du Nord.
- Si on invitait Primrose à diner un soir de relâche ? proposa Delphine.
- Bonne idée !
Hip avait la tête comme du béton. Sa mère voulait inviter Primrose ! C’était à hurler de rire. Un vaste cauchemar s’étendait à perte de vue devant lui. La voix de sa mère résonnait encore comme un écho rebondissant.
- Moi, je n’ai pas aimé son livre, dit le garçon.
- Pourquoi ?
- Je n’ai pas trouvé ça drôle. En plus, j’aime pas sa tête, il a l’air hypocrite.
- Tu l’as rencontré ? demanda Delphine.
- Oui, il est venu au collège pour parler de son livre.
- Ce n’est pas quelqu’un de très expansif, c’est vrai, reprit Nicolas. Il a des soucis en ce moment, le metteur en scène m’en a parlé. Ils sont très amis. Sa mère ne peut plus vivre seule et doit déménager dans une résidence spécialisée. Primrose est trop souvent absent pour pouvoir s’occuper d’elle. Il parait qu’il en est malade. Malheureusement, il n’a pas le choix. Sa mère perd la tête.
- Ah.
N’y tenant plus, Hip explosa :
- C’est faux, papa ! Archifaux ! Primrose ne s’occupe plus de sa mère depuis des années. Elle est seule ! Cela fait trente ans qu’elle l’attend ! C’est un sale type ! C’est un menteur !
- Mais enfin, Hippolyte, qu’est-ce qui te prend ?
- Parce que la vérité moi je la connais ! reprit-il sur le même ton tonitruant.
- Mais quelle vérité ?
- Primrose a été chassé de chez lui par son père parce qu’il avait été surpris en train de voler dans la caisse de la librairie où il travaillait pour se faire un peu d’argent de poche ! Ensuite il a disparu. Sa mère ne l’a plus jamais revu !
- Mais pourquoi tu pleures mon chéri ? Viens t’asseoir, et explique nous. Calmement.
Cela faisait du bien. C’était comme après la pluie un soir d’été. Le garçon raconta tout, depuis le portefeuille trouvé jusqu’au moment où il avait surpris Primrose en compagnie du promoteur immobilier.
Ses parents l’écoutaient en se jetant parfois des regards surpris. A la fin, son père demanda.
- Et tu lui as écris tout ça dans ta lettre ?
- Qu’est-ce que tu aurais fait à ma place ? demanda le garçon.
- Pareil, probablement.
- Faut que je vous dise quelque chose, reprit Hip. Je n’ai pas été au collège aujourd’hui. Car je n’avais pas envie de le voir.
- On le savait déjà, avoua Delphine.
- Ah bon ?
- On voulait t’en parler… ta prof de français nous a appelés.
- Pour dire que je n’étais pas en cours aujourd’hui ?
- Oui, et pour nous entretenir au sujet de ton texte. Elle l’a trouvé très… très original. Sophia et Scorpion ! Ca lui a beaucoup plu.
- Le problème, reprit Nicolas, c’est que ta prof de français est une férue d’opéra, et qu’elle a clairement reconnu dans ton histoire l’intrigue de Tosca de Puccini. D’accord, tu as changé les noms et les lieux, mais c’est quasiment la même histoire.
- Elle a quand même décidé de te mettre une bonne note, enchaîna Delphine, parce qu’il rare qu’un élève s’inspire d’un opéra. D’habitude, c’est plutôt les séries télé.
Hip préféra renoncer aux explications, à savoir qu’à un moment, il s’était perdu entre rêve et réalité, à cause d’une fille, Sophia, mais que tout ça était maintenant terminé. Il préféra se blottir contre sa mère, la vraie Tosca, pendant que son père rangeait les partitions pour libérer la table.
- C’est incroyable que tu connaisses la mère de Primrose, dit Delphine. Mais comment l’as-tu rencontrée au fait ?
- Mais maman, je te l’ai déjà expliqué. Je lui ai rapporté le portefeuille qu’elle avait perdu devant la poste.
- Ah oui, c’est vrai.
- J’ai l’impression parfois que tu n’écoutes pas ce que je dis.
- Risotto aux cèpes pour tout le monde ! claironna Nicolas.
Hip n’avait pas faim. Ses parents n’avaient pas cru un mot de son histoire, c’était hallucinant. Il se demandait pourquoi il continuait de leur parler. Chacun portait un regard distinct. Nicolas avait peut-être la version du metteur en scène, un ami de Primrose, mais Hip, celle de la principale intéressée, la mère de l’auteur. Et ces deux voix ne racontaient pas la même histoire. Selon eux, Marguerite perdait la tête, mais c’était logique. Le chagrin lui avait brûlé le cerveau. C’était une conséquence de la disparition de son fils. Primrose était un hypocrite, il y avait confirmation. Il faisait croire ce qui l’arrangeait, et forcément, il préférait se donner le beau rôle. Seul Hip savait que la vérité était ailleurs.
Il n’eut aucun mal à trouver le sommeil cependant. Il fit un rêve aérien, un peu cotonneux, dans un immense ciel tiède.
***
Le lendemain était un mercredi. Après être passé au conservatoire pour son cours de piano, il baguenauda jusqu’au quartier de madame Delange. Arrivé devant l’immeuble, il découvrit des meubles sur le trottoir, et n’eut aucun mal à reconnaître ceux de la vieille femme. Parfois quelqu’un s’arrêtait pour prendre quelque chose, un tapis, une chaise, une lampe… Le garçon s’engouffra sous le porche et grimpa les marches quatre à quatre. Arrivé au sixième, essoufflé, il trouva la porte ouverte. Marguerite était en train d’emballer des verres dans du papier journal.
- Qui êtes-vous ? demanda-t-elle.
- C’est moi, Hippolyte, répondit le garçon.
- Tu es le livreur de chez Monoprix ?
- Exactement, répondit le garçon.
- Viens m’aider, Hippolyte, dit-elle. Je voudrais que tu pousses cette malle contre le mur, trop lourde pour moi.
- Qui a descendu les meubles en bas ?
- Ce sont eux ! Ils sont toute une équipe, comme un essaim de frelons.
Le garçon regarda autour de lui. L’appartement était sans dessus dessous. Il paraissait plus grand ainsi, sans les tapis et les meubles.
Le garçon prit une inspiration.
- Madame Delange, j’ai vu votre fils, je sais où il est. C’est lui qui vous envoie en maison de retraite.
La vieille femme se redressa. Une tasse lui échappa des mains et se brisa sur le sol.
- De quel fils parles-tu, Hippolyte ?
- De votre fils qui est parti il y a longtemps, vous vous souvenez ?
- Non, je ne me souviens pas. Je n’ai pas de fils qui est parti.
- Si, madame Delange, vous me l’avez raconté. Votre fils que votre mari a jeté dehors il y a longtemps. Ce fils que vous attendiez, je l’ai vu, je sais où il est, il vit à Lille, comme vous, pas loin.
- Qui ça, mon fils ? Mais je n’ai pas de fils. Tu vois ces tasses, c’était notre service de mariage.
Hip n’insista pas. Elle n’écoutait pas ce qu’il lui disait. Il déambula dans l’appartement sonore, le parquet craquait sans les tapis. Il restait ci et là des choses éparses. Hip s’agenouilla devant un carton de livres et feuilleta un vieux numéro de Spirou. Puis son regard fut attiré par plusieurs exemplaires d’un même livre. Couverture identique, même titre, même nom d’auteur. Primrose. Le miroir incassable. Nouvelles.
Le garçon déglutit. En entendant les pas de madame Delange, il reposa rapidement le livre qu’il tenait et déposa le Spirou par-dessus.
- Si tu veux des livres, dit Marguerite, sers-toi.
- Pourquoi vous avez tant d’exemplaires du Miroir incassable ? demanda Hip.
La vieille femme ne se troubla pas.
- Je ne sais pas, dit-elle. J’ai accumulé tant de choses durant toutes ces années..
Sous le coup de l’impulsion, Le garçon lui plaça le livre de Primrose sous le nez.
- Vous connaissez ? demanda-t-il.
- Oui, ce sont les livres de monsieur Primrose. Mon mari se faisait appeler ainsi lorsqu’il écrivait. Moi aussi, durant un temps, j’ai été une madame Primrose. C’est tout de même mieux que Delange, n’est-ce pas ?
Ne sachant que répondre, Hip opina. Il avait envie de pleurer parce qu’il ne comprenait pas. Il avait l’impression que la vieille femme s’était muée en sorcière et qu’elle le manipulait avec des histoires sans queue ni tête. Il se sentait prisonnier de cet appartement vide.
- Je vais faire du thé ! annonça Marguerite.
Elle revint un instant plus tard.
- J’avais oublié, ils ont emporté ma cuisinière.
- Vous allez dormir où ce soir ? demanda le garçon, qui ne voyait plus de lit nulle part.
- Chez ma sœur… non, pas chez ma sœur, elle est morte il y a dix ans… je sais que je vais dormir quelque part, mais je ne sais plus où…
Hip lui prit la main mais la vieille femme se déroba.
- Qui êtes-vous ? demanda-t-elle à nouveau. Vous feriez mieux de partir avant qu’ils ne reviennent.
Hip avait déjà vécu cette scène lorsqu’il était en cavale, fuyant Scorpion, le chef de la Milice. Un matin, Sophia était arrivée pour le prévenir qu’il fallait fuir d’ici, mais il n’avait pas eu le temps de passer par le toit. Des hommes avaient ouvert la porte à coups de bottes et s’étaient jetés sur lui. Sophia les avait suppliés de le lâcher et ils l’avaient giflée. Aujourd’hui c’était Marguerite qui l’informait d’un danger imminent.
- Va-t-en, dit-elle. Ils seraient capables de t’enfermer dans une malle et de t’expédier à l’autre bout du monde.
13/
Il sut, le jeudi, en pénétrant dans la cour du collège, qu’il s’était passé quelque chose durant son absence. Des têtes se retournaient sur son passage, et cela n’avait aucun rapport avec son bonnet tricoté.
Il se dirigea dans la direction de Sophia mais la jeune fille l’ignora ostensiblement. En cours d’anglais, il entendit des rires lorsqu’il prit la parole. Ce n’était pas à cause de son accent australien (contracté à Sydney), parce que personne n’était capable de l’identifier. Non, il sentait une atmosphère différente, une sorte d’émoi derrière lui, comme si quelqu’un lui avait collé un poisson d’avril dans le dos. Et Sophia devenait rouge écarlate dès qu’il se tournait vers elle. Ce n’était plus lui qui rougissait, c’était elle ! C’était le monde à l’envers, la terre qui s’emballait dans l’autre sens. Pourquoi Sophia était-elle si mal à l’aise. C’était étrange, d’autant que Hip avait accompli un immense travail sur lui-même pour la considérer désormais comme une simple copine de classe et rien de plus. Au début, cela avait pourtant fonctionné. Sophia et Hip avaient réussi à se parler normalement, de personne à personne, sans bégayer ni suer à grosses gouttes.
A la récré, armé de courage, Hip coinça Sophia au sortir d’un couloir.
- Qu’est-ce qui se passe ? demanda-t-il. Pourquoi tu me fais la gueule ?
- J’ai eu la honte de ma vie à cause de toi.
- Qu’est-ce que j’ai fait ?
- La prof de français a lu ton texte devant tout le monde.
- Quel texte ? demanda Hip, en regrettant déjà sa question idiote.
Des larmes remplirent les yeux de la jeune fille.
- Tu aurais dû me demander mon avis avant de donner ton texte. Maintenant, tout le monde est au courant.
- Au courant de quoi ?
- Tu sais bien !
La mémoire de Hip se remit en route. Le texte… oui, ça y était, il se souvenait. Tosca sous les traits de Sophia, leur amour, Scorpion…
- De toute façon, c’est de la fiction, dit-il, un peu lâchement.
- Qu’est-ce que tu veux dire ?
- C’est une histoire inventée, une histoire qui n’existe pas. Ce n’est pas la vérité, ajouta-t-il, en regrettant ses mots.
- Pourquoi tu as mis nos prénoms alors ?
- Ben, comme ça…
- Tu n’as pas le droit d’écrire n’importe quoi ! Tu t’es servi de moi !
- Pas du tout !
- Si, t’es nul ! Moi j’ai pensé que c’était vrai, que tu avais écris ce texte parce que tu avais peur. J’ai trouvé que c’était une très belle histoire d’amour. Mais si c’est de la fiction, alors, tant pis.
Sophia, les yeux embués de larmes, tourna les talons et s’élança dans le couloir. Hip demeura les bras ballants, K.O. Il ne s’était jamais senti aussi bête. Durant tout le reste de la journée, il essaya d’analyser ce que lui avait dit exactement Sophia. C’était le quiproquo intégral. Sophia aurait souhaité que le texte soit en fait l’expression exacte de ce qu’il ressentait. Et il avait démenti… Mais c’était faux, archifaux ! Hip le savait : il avait écrit ce texte pour partager avec Sophia une belle et romantique tragédie amoureuse. Il n’avait pas cessé de penser à elle, de nuit comme de jour, en écoutant l’opéra, la découvrant derrière le visage de Tosca. Il avait cherché à se rapprocher d’elle jusque dans l’opacité de ses rêves. La situation présente faisait penser au contraire à un livret d’opéra où les personnages, enfermés dans une musique de malentendus, se poursuivent sans jamais se rattraper.
Maintenant, Sophia le fuyait pour de bon. Et l’histoire se terminait avant même d’avoir réellement commencé. Cela s’appelait la fin du monde.
Hip se moquait de ce que les autres pouvaient penser de leur histoire. Il avait fait une erreur en donnant ce texte à la prof. Il aurait dû l’offrir directement à Sophia, ou bien le jeter à la corbeille.
Comment réparer les dégâts ? Lui écrire une vraie lettre d’amour ? Hip soupira. Quelque chose en lui attirait les complications.
***
On aurait dit une terre sans arbres, défigurée. L’appartement vide penchait vers le délabrement. Les fenêtres étaient ouvertes sur des volets clos qui filtraient la lumière. Hip arpenta les pièces nues, replaçant mentalement les meubles et les tableaux. Il restait quelques remugles de chat crevé et de poussière.
Hip remarqua le sac à main de Marguerite posé sur le rebord de la cheminée. Elle l’avait oublié. Cela arracha un sourire au garçon qui s’en empara.
14/
Sur la route de Mouscron était érigé un bâtiment moderne entouré d’un parc. Un arrêt de bus était planté devant. A deux pas se trouvait également un complexe commercial qui attirait les familles en ce samedi. Il faisait beau.
Le parc, avec ses petites allées ponctuées de bancs, ressemblait à un terrain de golf. Voiturettes électriques et chaises roulantes s’y croisaient dans la douceur printanière. Hip avança sur l’esplanade et remarqua une vieille femme, chauve comme lui, recroquevillée dans son fauteuil, les membres amorphes, qui babillait. Il trouva qu’avec sa peau rose toute fripée, elle ressemblait à un nouveau né. Sa bouche édentée remuait, articulant des mots sans syllabe. En apercevant le jeune garçon coiffé d’un bonnet tricoté, l’émerveillement tapissa son regard. Une infirmière arriva pour la conduire à l’intérieur et Hip crut entendre son cri muet qui vibrait pareil à un appel au secours.
C’est alors qu’il les aperçus, dans l’allée centrale qui coupait le parc d’Est en Ouest. Deux silhouettes n’en formant qu’une dans cette étendue végétale plongée dans une lumière zénithale. On aurait dit un couple évoluant dans la perspective fuyante d’un tableau, se détachant du réel par un effet de surimpression. Primrose tenait sa mère par le bras, la tête penchée d’un côté, comme pour écouter ce que lui racontait sa vieille mère. A un moment, ils prirent place sur un banc et regardèrent cette nuée d’oiseaux qui traversait le ciel, traçant dans le ciel une immense arabesque.
Hip continua à les observer de loin. Il ne comprenait pas davantage le sens de cette histoire à rebondissements, mais lorsqu’il vit l’auteur serrer sa mère dans ses bras, il se sentit submergé par une intense émotion. Et il aurait voulu à cet instant être une particule d’air pour entendre ce qu’ils se chuchotaient.
Il s’avança au moment où le couple passait devant lui, près des portes du grand hall, pour rendre le sac à main à la vieille femme. Elle regarda le jeune homme mais ne le reconnut pas. Elle prit son sac comme si elle l’avait oublié cinq minutes plus tôt sur le banc et continua son chemin silencieux vers la porte. Ses pieds glissaient sur le sol.
Le regard du garçon croisa celui de l’écrivain.
- Merci, chuchota Primrose. Attends-moi, je reviens dans un instant.
***
Un peu anxieux, Hip patienta dans le hall, près d’une machine à sodas. Il avait compris qu’il se passait quelque chose d’anormal lorsque Marguerite l’avait regardé avec des yeux vides. Elle ne lui avait pas présenté son fils qui se tenait à ses côtés. Elle était devenue l’ombre d’elle-même.
Hip guettait la porte d’ascenseur. Primrose allait certainement lui passer un bon savon, rapport à la lettre qu’il lui avait envoyée. Mais le garçon était content d’avoir rapporté ce sac à mains. Il était heureux aussi d’avoir revu Marguerite, même si elle ne s’était rendu compte de rien.
Les portes s’ouvrirent sur la silhouette dégingandée de Primrose. L’auteur se cachait le visage avec la main. Lorsqu’il arriva devant la machine à sodas, Hip constata qu’il pleurait. Secoué par des convulsions silencieuses, l’écrivain n’arrivait pas à parler.
- Elle… elle me prend pour mon père, lâcha-t-il enfin, d’une voix déchirée. Elle perd complètement les pédales.
Il prit le garçon par l’épaule et l’entraîna dehors.
- Viens, dit-il, j’ai ma voiture au parking.
Il roulait vite avec la bouche crispée. A chaque virage, Hip avalait des spaghettis. Le cauchemar continuait et il se sentait totalement impuissant. Le silence, tendu comme la corde d’un arc, se relâcha lorsque Primrose se gara dans le centre ville de Lille, près de l’hôtel du garçon.
- Ca va me faire du bien de passer la soirée avec vous, dit-il.
Hip ne sut pas quoi répondre. Sa mère avait dû l’inviter à diner et personne ne lui avait demandé son avis.
- Je t’ai connu lorsque tu étais bébé, continua Primrose. C’était à Marseille, tes parents étaient venus écouter ma pièce. Tu n’avais pas bronché pendant tout le spectacle. Tu dormais tranquillement dans ton couffin.
Hip baissa les yeux. Il savait déjà tout cela.
- Il est bien ton texte, reprit l’homme. Très touchant, de bonne construction. Et puis j’ai trouvé ta démarche courageuse, surtout très humaine. C’est rare à ton âge. Ma mère m’avait parlé d’un petit bonhomme avec un bonnet tricoté sur la tête. Un livreur de chez Monoprix ! Il ne faut pas lui en vouloir…
- Je ne lui en veux pas, dit Hip, la gorge serrée par l’émotion.
- Tu sais, j’ai mis longtemps à me rendre à l’évidence qu’elle ne pouvait plus vivre seule. Cela devenait extrêmement dangereux. Elle ne se rendait plus compte du danger. Elle pouvait sortir en chemise de nuit ou se faire cuire un steak à trois heures du matin, elle dormait le jour, oubliait de fermer les robinets. Quand son chat est mort, elle n’a pas voulu s’en séparer. Elle a gardé ce petit cadavre auprès d’elle et continuait de lui parler.
- Vous… vous n’êtes jamais parti alors ?
- J’ai pris une chambre quand j’avais vingt ans, mais je ne suis jamais resté plus d’une semaine sans venir la voir.
- Et votre père ? Elle m’a dit qu’il vous avait chassé de la maison.
- Ca n’a jamais été très facile avec mon père, mais nous sommes toujours restés en bon termes. Petit à petit, après sa mort, elle a commencé à nous confondre. Son état s’est ensuite dégradé très vite, elle se mettait à voir des ennemis partout, elle se sentait persécutée de toutes parts, et chaque fois il fallait du temps pour la ramener à la raison, jusqu’au jour où c’est devenu impossible. Elle a basculé dans une sorte de monde parallèle, avec des moments de lucidité, et d’autres où elle mélangeait tout, les situations, les gens… Alors je me suis dit que je devais faire quelque chose avant qu’il n’arrive quelque chose de grave.
- Je suis désolé pour la lettre.
- Tu as bien fait. Il y a tellement de vieux qui sont abandonnés. Tu ne pouvais pas deviner que ma mère ne l’était pas. Ce qu’elle t’a dit, elle l’avait déjà raconté à d’autres. Un jour, une assistante sociale à qui elle avait fait ses plaintes est venue me demander pourquoi je ne m’occupais pas de ma mère. C’est à partir de ce moment que tout a vraiment basculé.
Delphine avait préparé une tourte aux poireaux bio et saumon. En compagnie de Hip, Primrose était allé acheter une bouteille de champagne. Le garçon eut droit à une demi-coupe et il se goinfra de chips. Après le dessert, pendant que les adultes discutaient, il profita de ce ronron rassurant pour s’endormir dans un fauteuil. Il était avec Sophia et lui parlait dans le tunnel de ses songes. Ils vivaient ensemble dans une cabane construite dans un arbre, et au milieu de la pièce trônait un immense radiateur en fonte qui tenait dans les airs comme une feuille portée par le vent.
Lorsqu’il se réveilla dans la nuit, il constata qu’il était maintenant dans sa chambre, et que dans le second lit, d’habitude inhabité, dormait un homme nommé Primrose. Un détail attira son attention. L’écrivain ronflait comme sa mère. On aurait dit une même famille d’instruments. « Il gonflait très lentement les poumons, puis lorsqu’il expulsait enfin l’air, cela produisait un sifflement rappelant la douceur séraphique de la scie musicale ou de la flûte indienne ».
***
Lorsque Hip ouvrit son ordinateur pour taper un texte censé gagner le Guinness de la lettre d’amour, il se heurta à un mur blanc, totalement impénétrable. Trouver le premier mot fut d’une difficulté sans nom. « Sophia », trop raide, « Ma chère Sophia » trop guindé, « Ma petite Sophia » nul, elle faisait partie des plus grande de la classe, « Ma chérie » bof, son père utilisait déjà la formule pour entrer en contact avec sa mère, « Mon amour »… Il s’arrêta, lu, relu… ça avait de la classe, c’était global, titanesque, cela replaçait Sophia sur le podium de Tosca. L’ambigüité n’existait pas. Pour autant, il effaça la formule, réduisant sa page au silence. Les mots l’effrayaient soudain. La voix de Sophia lui revenait en mémoire « tu n’as pas le droit d’écrire n’importe quoi ! » Hip avait l’impression que les mots en cachaient d’autres et qu’il était impossible de les maitriser, un peu comme ces bombes à retardement. Cela le bloqua définitivement. Et puis franchement, écrire une lettre d’amour à l’ordi, ça n’avait rien de très romantique. C’était son écriture à lui qui comptait, pas celle d’une imprimante. Non, il ne pouvait pas se lancer dans pareille entreprise. Pour commencer, il n’avait pas pris de cours d’écriture de lettre d’amour. Cela ne devait pas s’improviser.
Et puis, qui lui disait que Sophia lirait la lettre ? Il ne devait pas oublier qu’elle était fâchée contre lui. Une lettre pouvait se perdre également, cela arrivait rarement, mais avec lui, rien n’était impossible dans ce domaine.
Il choisit une feuille avec des portées musicales. Accrochées entre elles, les notes dessinèrent un chant pur, presque naïf, comme un lointain scintillement de rivière. Deux voix se suivaient, se répondaient, se croisaient, s’enchevêtraient. L’harmonie était simple mais avec des moments de tension, des silences suspendus, des résolutions douces, fragiles comme des mains tendues l’une vers l’autre. A la fin, au somment d’un arpège ascendant, une danseuse se hissait sur ses pointes, jusqu’à s’enflammer dans la résonnance du point d’orgue.
Au fond, c’était cela, l’opéra, transformer les sentiments en musique.
Demain, il jouerait sa composition sur le piano de la B115, devant Sophia. Et il verrait bien. Après tout, un radiateur virtuose du clavier, ce n’était pas si courant.